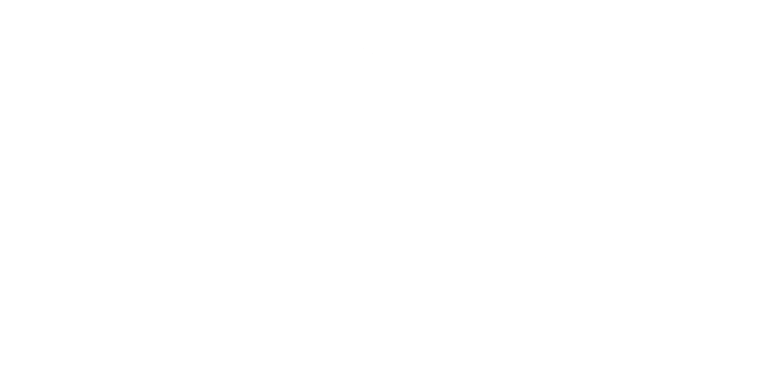Artiste et auteur·e
La pratique photographique de Beau Gomez active la narration et le champ des possibles qu’elle offre : comment est-elle un véhicule pour illustrer la mémoire, un point opératoire de tension et d’affect ? Comment permet-elle l’exercice radical d’être un témoin présent ? Travaillant le portrait sous toutes ces formes, Gomez pointe sa lentille vers ses sujets de manière à créer un dialogue avec ceux-ci. À travers un regard empathique, ses images construisent une filiation et un soin de ses sujets. L’essentiel de son travail consiste à mettre en lumière le caractère et l’image projetée de la personne captée, qu’ils soient réels ou performés. Cette pratique lui permet de faire sens de son monde, et de ce qu’il voit, de ce qu’il vit.
À Est-Nord-Est, Gomez arrive avec un projet précis, qu’il rumine depuis un certain temps : c’est maintenant le moment de tourner la lentille vers lui-même. Son but : comprendre ce qu’il traverse, comment, avec empathie, il peut prendre soin de lui-même. Braquer l’objectif sur lui-même est devenu une nécessité : il se devait de se porter une plus grande attention, de magnifier sa propre réalité. Cet autoportrait le réconcilie avec le fait de vivre avec le VIH. Il fait le choix conscient de continuer de mener sa vie, mais surtout celle d’artiste : à quoi sa vie peut ressembler maintenant qu’il n’est plus en mode survie ? Lorsqu’il a reçu son diagnostic, il s’est beaucoup auto-stigmatisé ; c’est en s’offrant la même compassion qu’il a normalement pour ses sujets que cet autoportrait lui permet de désapprendre ce réflexe qui n’a fait que nuire à son épanouissement.
Gomez a d’abord en tête une idée claire de l’image qu’il souhaite produire, sans toutefois deviner le résultat final : celui-ci apparaît lorsqu’il développe son film. Il y a, selon lui, un élément spirituel à l’utilisation d’une caméra argentique : cette « apparition » est primordiale à sa conception de projet, et à une captation sensible de ses sujets. En plus de sa caméra, il utilise régulièrement un enregistreur audio, qui amplifie et défie ce dont il souhaite parler, mais qui élargit également l’image. L’audio permet de faire sens de son diagnostic, de sa vie : c’est une manière tangible de percevoir son monde, mais aussi d’avoir une écoute active envers lui-même.
À travers son projet de résidence, Gomez s’autorise à être vu autant qu’il voit ses sujets. Il s’enthousiasme à l’idée de pouvoir montrer comment les gens vivant avec le VIH peuvent vivre, aimer, s’amuser, être sexuels, prospérer. Qui documente les personnes marginalisées ayant ce diagnostic avec tendresse ? Comment actualiser le regard historiquement tourné vers des artistes hommes blancs comme Robert Mapplethorpe ou David Wojnarowicz ? Grâce au mentorat de Richard Fung ou Darien Taylor, à des amitiés collaboratives avec Beto Pérez et Lírio Nascimento, et en étant le facilitateur de groupes de soutien, tant au Canada qu’à l’international, Gomez s’engage politiquement dans sa pratique artistique, construisant un langage transformateur autour du diagnostic.
À découvrir
Infolettre
Soyez informé·e·s des dernières nouveautés !