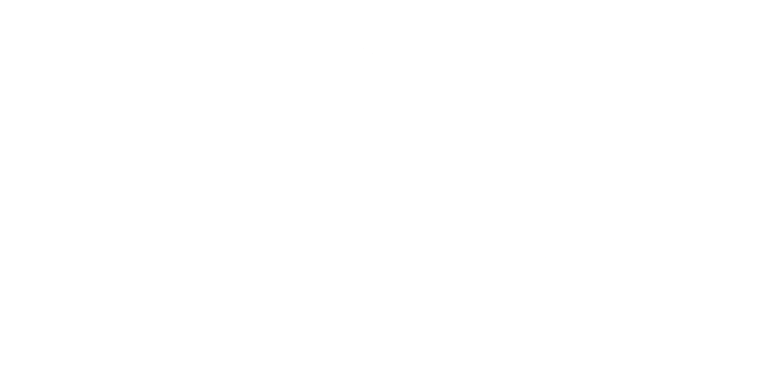Artiste et auteur·e
Miae Son (손미애) développe une pratique qui interroge la perception du monde à travers son expérience personnelle — cognitive, émotionnelle, corporelle et sociale. Ses œuvres allient une sobriété plastique et une attention au langage qui, à la réception, les inscrivent dans un courant proche de l’art conceptuel. L’apparente rationalisation ne vise cependant pas à résoudre le réel, mais à faire surgir, dans l’opacité même, ce qui résiste à la compréhension, ce qui est perçu comme insoluble ou dissonant. Dans son processus de création, l’automatisme ainsi que d’autres procédés proches d’un travail psychanalytique permettent à l’artiste d’explorer — à travers la mémoire du corps et la répétition du geste — certaines dimensions somatiques de l’identité. Lors de cette résidence à l’étranger, la question de l’appartenance s’est imposée comme fil conducteur.
Miae Son a modelé en argile une série de becs — inspirés des oiseaux « parleurs » comme les corneilles ou les perroquets — ainsi que sa propre oreille, sculptée à partir d’un miroir dans un geste d’auto-observation documenté en vidéo. À ces formes s’ajoutent des doigts aviaires, creux et griffus, conçus comme des prothèses à enfiler, à mi-chemin entre parure, extension défensive et marionnette. Réalisés dans une variété d’argiles naturelles — dont la variation évoque celle des corps, des voix et des langues —, ces objets performatifs déplacent le langage vers des interfaces sensibles, où s’expriment les tensions de la transmission, du malentendu et de l’altérité.
Immergée dans un environnement francophone, Miae Son trouve dans les sonorités du français et le processus associatif du langage la source d’une « petite épiphanie ». Elle est saisie par le fait que, dans la prononciation du mot maison, elle entend son propre nom, tandis qu’en Autriche, son pays d’accueil, c’est « comme si son nom n’existait pas », tant il demeure imprononçable pour les locuteurs allemands, même romanisé. S’entendre appelée dans ce signifiant étranger qui désigne le lieu où l’on vit — espace intime et commun de la mémoire — devient une expérience affective à déplier. La polyphonie du phonème son (손) se révèle d’une résonance singulière : en français, il unit perception auditive et indice d’attachement ; en coréen, il désigne la lignée, le nom transmis — et sa graphie évoque, dans sa simplicité, le contour d’une maison.
Accueillant l’incompréhension de cette découverte, comme pour mieux l’incorporer, l’artiste a mené une série d’exercices d’écriture automatique et poétique à partir du nom propre, du mot commun, des sons et des graphies. Ce jeu de translittération sonore a donné lieu à un dispositif de semelles gravées — « mai » sous un pied, « son » sous l’autre — où le mot maison fait écho, pas à pas, à l’écriture hangeul de son nom (손/son, 미애/miae). En février, ainsi chaussée, l’artiste s’est extirpée du studio par la porte de derrière, dans la direction que prennent les artistes à Est-Nord-Est pour trouver le champ et le vent. Ses traces, sa maison, comme une litanie chuchotée à la vastitude. Puis elle est rentrée, emportant un prélèvement de son passage : neigeux, fragile. Elle l’a déposé sur le sol chauffé du studio et en a filmé la fonte, épongeant patiemment jusqu’à l’effacement.
À découvrir
Infolettre
Soyez informé·e·s des dernières nouveautés !