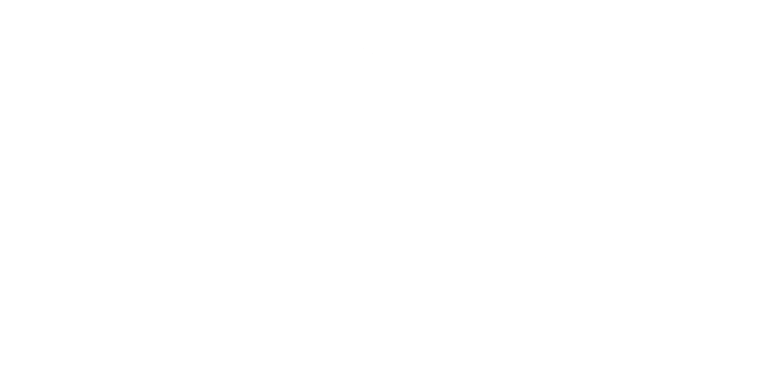Artiste et auteur·e
Avec Céline, notre conversation en février à Est-Nord-Est a commencé sur l’observation que l’espace dégarni du studio que j’occupais temporairement lui faisait du bien, parce que de l’autre côté du mur, celui qu’elle avait fait sien depuis 6 semaines était désormais bien différent… C’est qu’en cherchant à donner forme à son texte, elle l’a fait sortir de la page et de l’écran. Elle l’a imprimé, découpé, l’a étendu sur le mur et sur le plancher… Cette manière de faire et d’occuper son espace pour écrire est certainement ce qui a le plus captivé le groupe avec qui j’étais venu visiter son studio la veille. La rigidité du bon écrivain assis à sa table, m’a-t-elle dit, est une image dont j’ai dû apprendre à me détacher. Oui : il faut écrire avec tout son corps, tous ses sens, nous sommes-nous rappelées, ne pas s’oublier dans les idées éthérées. Pour moi en tout cas, cette possibilité de mouvements — tout comme l’espace blanc de la résidence, ou celui de la page — est une sorte de permission féministe que je dois moi-même m’accorder. Ainsi, le questionnement au fondement de la démarche qui occupe Céline actuellement m’interpelle fortement : qu’est-ce que cela veut dire pour une artiste, d’être invisible ou de prendre sa place ?
Le livre que l’auteure Céline Huyghebaert est sur le point d’achever à Est-Nord-Est — celui qui est appelé à suivre Le drap blanc et son succès retentissant — est l’aboutissement d’un cycle de recherche-création qu’elle a construit sur plus de 6 ans. Pour celui-ci, elle a commencé par deux résidences en archives (à La chambre blanche en 2016 et à Artexte en 2018) avec la question de savoir avec quels mots parle-t-on de l’art produit par les femmes. Elle a pris des notes sur des expositions passées, lu des publications, photocopié des feuillets d’exposition, des communiqués de presse, etc. Mais, comme elle me l’a dit, à un certain point devant toutes ses listes de vocabulaire compilé, elle s’est rendu compte que ce type d’analyse pourrait tout aussi bien être réalisée, voire mieux, par un programme informatique. Que ce qu’elle cherchait, en fait, ne pouvait pas y être… Non : parce que, pour connaître les freins, les doutes, les échecs dont font l’expérience les artistes femmes, il aurait fallu que soit conservé une trace de ce qui existe entre les mots. Céline a donc poursuivi en constituant son propre fonds d’archives avec ce qu’elle appelle les « œuvres fantômes », en demandant à des artistes de lui raconter chacune une œuvre jamais réalisée. Le cycle s’est ensuite développé sur la base de ces fouilles en deux expositions qui présentaient des lettres issues d’une correspondance fictive entre elle, Céline, et une amie artiste anonyme (« Un cas particulier/A Specific Woman » et « Tes suppressions », respectivement à Occurrence en 2021 et à Caravansérail en 2024).
Céline parle de son projet de livre comme d’une courtepointe ou d’une tapisserie, d’une œuvre qui sera construite sur l’ouvrage du collectif. Et la question qui me brûle depuis la visite du studio la veille est celle de savoir comment, concrètement, on arrive à écrire seule en tissant avec toutes les voix. Justement, m’a-t-elle confié, je crois qu’en ce moment, j’hésite entre deux projets et qu’entre les deux, la distinction centrale est celle de déterminer la posture à choisir devant l’effacement, le mien et celles des artistes qui m’ont répondu…
Une œuvre d’art qui n’a jamais existé peut-elle exister quand même ? Pour celles qui se sentent invisibles, la réponse est souvent non, mais est-ce que dire leur non-existence n’est pas un processus d’empuissancement qui les fait exister ? Au moment de rédiger ces lignes, j’ignore la version du livre que Céline a écrit — si elle a pu le terminer, à quel moment, et si elle doute. Mais tout comme l’image d’elle qui se tient devant son mur noirci d’une belle tourmente, ce livre qui pourtant n’existe pas (encore) me hante néanmoins.
À découvrir
Infolettre
Soyez informé·e·s des dernières nouveautés !