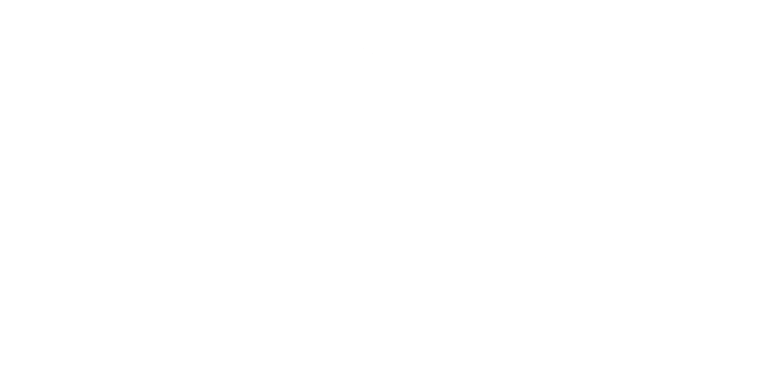Richard Ibghy et Marilou Lemmens
Texte-témoin
À l’hiver 2024, le duo d’artistes Richard Ibghy et Marilou Lemmens s’installe à ENE pour poursuivre leur série sculpturale Les faits alternatifs du 21e siècle, amorcée en 2022. Déjà présentée à la Fondation Molinari au Québec et à la Jane Lombard Gallery à New York — qui les représente depuis une dizaine d’années —, la collection s’enrichit ici de nouvelles œuvres, destinées à être proposées aux collectionneurs. Durant leur résidence, ils ont produit près d’une trentaine de pièces dans cette cadence fluide qui semble être la leur — intensifiée peut-être par la coïncidence extrême entre espace de vie et espace de travail au studio, ainsi que par les impératifs temporels de la céramique. Il s’agit d’une routine d’atelier devenue presque seconde nature, marquée par un équilibre de rigueur, de joie tranquille et de plaisir manifeste à créer ensemble.
Relativement marginale au sein de leur corpus et remarquable par son usage de la figuration, la série Les faits alternatifs du 21e siècle prolonge la recherche d’Ibghy-Lemmens sur la matérialisation des abstractions et la critique de leurs effets, notamment la simplification du réel, la mise en évidence de certains éléments et l’invisibilisation d’autres. Elle s’inscrit dans leur exploration du para-monument, incarnée dans des projets tels que 1+1+1=1 (2021), une œuvre d’art publique qui détourne les modes de visualisation des statistiques pour mettre en lumière des faits numériques négligés, ou encore L’affaire Louis-Robert (2020) qui, sans se revendiquer formellement du para-monument, re-présente des données scientifiques censurées pour préserver la mémoire de leur effacement. Avec Les faits alternatifs du 21e siècle cependant, l’approche des artistes du para-monument prend un tour plus aigu, alors qu’ils choisissent de s’ancrer dans le méandre culturel et politique contemporain, transformé par l’ère de la post-vérité.
Il s’agit d’une inflexion qui se manifeste dans un contexte d’énonciation brouillé, où les récits qu’il s’agit de visibiliser ne se limitent plus à une mémoire marginalisée, destinée à enrichir un récit dominant, mais incluent des fictions sciemment construites pour servir des intérêts idéologiques ou politiques. En mettant ces récits en exposition, l’art ne risque-t-il pas de reproduire la désinformation et la confusion qu’ils engendrent ? Ce danger s’aggrave d’autant plus que l’un des effets majeurs de la post-vérité est l’érosion de la confiance envers les institutions — y compris celle de l’art et de la galerie. Mais Ibghy et Lemmens optent pour une posture critique discrète, fondée sur des procédés d’ironie qui reposent sur une complicité fragile avec le spectateur. Ce dernier, en effet, est invité à percevoir le décalage pour en saisir le sens, alors même que cette capacité d’interprétation, essentielle à la lecture de l’œuvre, est rendue incertaine par le climat de confusion généralisée. De toute évidence, ils misent sur le fait que l’art peut encore offrir un espace de résistance, et que la galerie, en ralentissant le regard, reste un lieu propice à des lectures plus complexes que celles conditionnées par les médias de masse et les plateformes numériques.
Si les artistes identifient, comme défi plastique et conceptuel de cette série, l’absence d’iconicité de leurs sujets — qu’ils condensent en associant image figurative et texte descriptif — pour une majorité des œuvres, leur recherche contribue à souligner le rôle central de l’image et des « preuves visuelles » dans la fabrication de cette pseudo-histoire. Sans dénonciation frontale, leur démarche éclaire les liens troubles entre image, vérité et fabrication. Face au pouvoir des images, ils nous rendent celui de regarder autrement — de questionner, de discerner, d’affûter notre jugement. Car ces supercheries, aussi absurdes soient-elles, ont des effets bien réels : les représenter, c’est aussi permettre qu’on s’en souvienne, pour ne plus s’y laisser prendre.
Biographie
Alliant une recherche rigoureuse à une exploration matérielle propre à chaque projet, la pratique collaborative de Richard Ibghy et Marilou Lemmens adopte des stratégies et des formats divers, incluant la réalisation de sculptures, de vidéos, d’installations, d’œuvres d’art public et de livres d’artistes. Depuis plusieurs années, ils se penchent sur l’histoire et le pouvoir des méthodes scientifiques, dont le langage de l’économie, la magie des statistiques, la capacité des modèles à influencer l’avenir, l’esthétique de la visualisation des données et le design des expériences en laboratoire. Plus récemment, leurs œuvres ont porté sur un élargissement des concepts d’hospitalité, de soin et de communication entre les espèces. Ils vivent à Durham-Sud, au Québec.
À découvrir
Infolettre
Soyez informé·e·s des dernières nouveautés !